« J’entretiens une relation de confiance ancienne avec mon patient. Au cours d’un entretien, il me confie un écart de conduite habituelle et m’avoue une relation extraconjugale à risque de transmission du VIH. Il me questionne sur les dangers qu’il a pris et la nécessité de réaliser un test de dépistage. Je lui conseille d’en discuter avec son médecin traitant mais, s’agissant d’un médecin de famille connaissant bien son entourage, il se dit réticent à lui parler. Très gêné par cette situation, il refuse de se rendre dans un centre de dépistage.
Je me questionne : ai-je le droit de lui prescrire ce test qu’il accepterait si je lui propose ?
Dois-je intervenir dans cette situation alors que je doute de l’étendue de mes responsabilités ? Comment assumer ma mission de santé publique pour protéger son épouse, son entourage s’il est infecté ? Je sais qu’il n’engagera rien dans l’immédiat si je ne suis pas actif dans ce processus… »
Réflexions du Professeur Ahmed Feki
Professeur Emérite de chirurgie orale – Université de Strasbourg
« Toute activité orientée selon l’éthique peut être subordonnée à deux maximes totalement différentes et irréductiblement opposées : L’éthique de responsabilité ou l’éthique de conviction. »
Max Weber (1864-1920)
Malgré sa singularité, la situation décrite est exemplaire, dans la mesure où elle oblige le praticien à une réflexion intellectuelle qui déborde sa pratique quotidienne. Elle l’interroge sur l’étendue de ses compétences et de sa responsabilité professionnelles. Cette situation est par ailleurs intéressante par l’acuité des « tourments » éthiques qu’elle soulève. Dans ce contexte, il est possible de structurer cette réflexion autour de deux volets : le premier concerne la compétence et la responsabilité professionnelles. Le second intéresse le questionnement éthique.
Les odontologistes sont souvent mal à l’aise face au VIH, comme ils le sont face au cancer. « Ai-je le droit de lui prescrire ce test qu’il accepterait si je lui propose ? », cette interrogation m’en rappelle une autre, souvent exprimée : « Ai-je le droit de pratiquer une biopsie face à une lésion de la cavité buccale à potentiel malin ? » En réalité, il me semble que ce ne sont pas ces questions qui sont primordiales, mais ce qu’elles impliquent en cas de positivité. En effet, c’est au praticien qui prescrit le test, ou qui réalise la biopsie, qu’incombe la responsabilité de l’annonce du résultat au patient. On peut alors s’interroger : l’odontologiste est-il le partenaire adéquat pour une telle annonce, et le cabinet dentaire est-il le lieu approprié pour apprendre sa séropositivité au VIH ou le diagnostic d’un cancer ? Dans un cas comme dans l’autre, la réponse est théoriquement positive, si l’on tient compte du niveau actuel de formation des praticiens depuis la réforme des études odontologiques et l’évolution de l’odontologie en « une discipline médicale à part entière », affirmation souvent proclamée. Après six années d’études supérieures, sanctionnées par un doctorat, l’odontologiste devrait être suffisamment armé (c’est là la mission de l’enseignement suivi et de la formation acquise) pour gérer ce genre de situations lorsqu’elles se présentent. Le rôle de l’odontologiste se limite incontestablement à cette étape initiale du diagnostic. La prise en charge globale relève bien sûr du spécialiste. Le praticien de « médecine bucco-dentaire », chaînon du système médical, assume ainsi pleinement et formellement sa mission de santé publique.
C’est dans ce contexte qu’émerge la réflexion éthique dans ses deux dimensions, personnelle et professionnelle. Dans la situation présente, le patient exprime sa réticence à se confier à son médecin de famille, dans un souci de discrétion et de confidentialité. Il rejette également la possibilité de s’adresser à l’un des nombreux centres de dépistage anonymes et gratuits. Cette démarche, relativement fréquente, du refus du test traduit l’appréhension, la peur d’être réellement infecté. Il imagine toutes les conséquences d’un tel « verdict » pour lui et pour son entourage (rejet, discrimination, risque de transmission…). La capacité du praticien à convaincre le patient de réaliser le test passe par son aptitude à lui permettre d’exprimer sa peur et son anxiété face aux enjeux, à le faire parler. Il est aussi essentiel de le persuader du bénéfice escompté en brisant la spirale de l’incertitude sur son statut sérologique. Plus la période de doute est longue, plus le coût psychologique pour lui sera lourd à porter. Il peut être salutaire de le conduire à confier son vécu de cettesituation à un référent d’une structure spécialisée, Sida Info Service (confidentiel, anonyme et gratuit). Il ne faut pas non plus négliger l’opportunité de réaliser, sous certaines conditions, un autotest de dépistage du VIH, disponible en pharmacie, en France depuis septembre 2015.
Pour toutes ces raisons, le questionnement éthique du praticien ne doit pas déboucher sur un statu quoaux conséquences potentiellement graves. Sans aller jusqu’à considérer le cabinet dentaire comme un lieu privilégié pour le dépistage du VIH grâce aux « tests rapides », comme dans certains services et cabinets dentaires à New York ou en Angleterre, lorsqu’une situation singulière se présente, il faut tout mettre en œuvre pour y faire face. L’odontologiste du XXIe siècle ne peut pas se contenter de soigner des caries et de confectionner des prothèses (actes nobles, fondamentaux et indispensables). Il ne doit pas se « dérober » devant certaines situations, forcément complexes et chronophages. Il me semble important de « dédramatiser » ces situations, heureusement exceptionnelles, où l’on est amené à annoncer au patient une affection grave, sous prétexte que ce dernier va s’effondrer et le praticien ne saura pas gérer cette annonce, par manque de formation. Le patient s’effondrera de toute manière, quel que soit le spécialiste qui lui fera cette annonce et quelle que soit sa formation.
Dans cette situation, oui, le praticien a le droit de prescrire le test. Oui, il a le devoir d’assumer sa mission de santé publique. L’important c’est l’appréciation du sens qu’il donne à son action, le palier des valeurs humaines (humanistes) qu’il véhicule et le niveau de la réflexion éthique qu’il intègre à sa pratique.
Réflexions du Docteur François Paysant
Maître de conférences à la faculté de médecine de Grenoble – Praticien Hospitalier
La relation médicale a toujours une part technique et une part humaine. Dans ce cas, je débuterais l’approche sur le versant humain, en complimentant le patient d’en parler et en lui faisant comprendre que cela dénote une prise de conscience de l’importance de la problématique et que rester dans l’ignorance va l’impacter psychologiquement à l’avenir. Comment vivre avec une telle épée de Damoclès ? Comment jouer à la roulette russe avec la santé de son conjoint ? L’idée est de lui faire admettre l’importance ne serait-ce que de savoir.
Venons-en à une argumentation plus technique sur les possibilités de traitements, et leur efficacité actuelle, mais aussi à la nécessité d’un traitement précoce, d’où l’impératif de dépistage.
Les mots sont lâchés : « Se faire dépister ». C’est un acte banal de routine que les médecins proposent régulièrement en dehors de tout facteur de risque : « Prenez le temps, cher Monsieur, de lire la brochure INPES sur le dépistage du VIH (www.inpes.sante.fr/CFESBases/catalogue/pdf/1323.pdf). »
Comment arriver à ce dépistage ?
Idéalement, c’est le rôle du médecin traitant ou d’un centre de dépistage anonyme et gratuit que de proposer ce dépistage, d’assurer l’annonce du résultat et, en cas de séropositivité, d’orienter vers les praticiens ou structures adaptées. La recherche des autres infections sexuellement transmissibles est également souhaitable. Proposer d’aller se faire dépister dans le centre de dépistage d’une autre ville à l’occasion d’un déplacement peut être une alternative à un refus.
Si le refus persiste, l’odontologiste peut-il prescrire ce dépistage ?
Réglementairement rien ne s’y oppose. L’article R 4127-238 du Code de la santé publique stipule ainsi que « le chirurgien-dentiste est libre de ses prescriptions, qui seront celles qu’il estime les plus appropriées en la circonstance. Il doit limiter ses prescriptions et ses actes à ce qui est nécessaire à la qualité et à l’efficacité des soins ». Prescrire un acte dans un esprit de prévention et de soin est tout à fait conforme à l’esprit de cet article. La problématique est la gestion d’un éventuel résultat positif. Un patient qui a refusé de prendre la voie du médecin traitant ou du centre de dépistage anonyme et gratuit risque de refuser toute prise en charge. Dans ce cas, le chirurgien-dentiste sera démuni tant en termes de suivi du patient que de prévention pour l’entourage. Rappelons que le secret interdit de transmettre l’information aux proches. Obligation est faite au praticien de convaincre son patient d’en parler à son ou ses partenaires.
Je ne préconiserai pas la simulation d’un accident d’exposition au sang qui permet de tester le patient source et donc de connaître par ce biais son état sérologique ; il ne me semble pas sain que le praticien recourt à un mensonge pour contourner une réticence non fondée.
Pour conclure, ce n’est pas la possibilité réglementaire qui compte mais la logique d’une prise en charge globale du patient. N’oublions jamais que l’annonce du résultat est aussi importante que la prescription de l’examen.
Réflexions du Docteur Anne Becart
Chirurgien-dentiste – Praticien hospitalier
Docteur en éthique médicale
Expert judiciaire près la Cour d’appel de Douai, agréée par la Cour de Cassation
Il semble difficile d’accéder à la demande de ce patient/ami pour plusieurs motifs.
Certes, au plan juridique, le praticien peut établir cette prescription, mais la compétence du chirurgien-dentiste en matière de rendu de résultats d’une sérologie VIH, et surtout d’implication dans la prise en charge ultérieure si nécessaire, restera limitée.
Son rôle ne peut se borner à établir une prescription, sans se soucier de ce qu’il adviendra ensuite. Les résultats ne peuvent parvenir au patient sans qu’il dispose de l’accompagnement adéquat pour lui transmettre ces résultats, répondre à ses interrogations et organiser avec lui la prise en charge, qui peut se révéler complexe en cas de comorbidités. À cet effet, le médecin de famille, qui connaît bien le patient, est sans doute le mieux placé pour appréhender ses réactions, et le respect du secret garantit la confidentialité que recherche ce patient. Si parler à son médecin traitant lui semble trop difficile, le recours à un centre de dépistage anonyme et gratuit est particulièrement indiqué et le praticien devrait convaincre son patient de s’y rendre.
Répondre à la demande de son ami par une réponse qui sera nécessairement scindée et incomplète ne semble pas être le meilleur service à lui rendre. La relation amicale évoquée peut être source de dilemme pour le praticien qui connaît sans doute également l’épouse et les enfants. Il paraît plus simple pour tous de s’adresser à une personne détachée affectivement qui pourra garder toute la neutralité nécessaire à la prise en charge de soins.
Si l’on se tourne vers les fondamentaux éthiques, le principe de bienveillance va ici se heurter au principe d’autonomie. L’autonomie, en l’occurrence le respect de la décision du patient de ne pas s’adresser à son médecin traitant ou à un centre de dépistage, ne répond pas au respect du principe de bienveillance, qui consiste ici à conseiller au patient de s’orienter vers une structure adaptée à une prise en charge de qualité.
En tant que professionnel de santé, le chirurgien-dentiste doit convaincre le patient de se faire prendre en charge par un médecin. Sollicité en tant qu’ami, le praticien, s’il ne peut se substituer au médecin pour la prise en charge du dépistage et des soins, peut toutefois proposer d’accompagner la personne dans les démarches qui lui paraissent difficiles en tant personne de confiance.

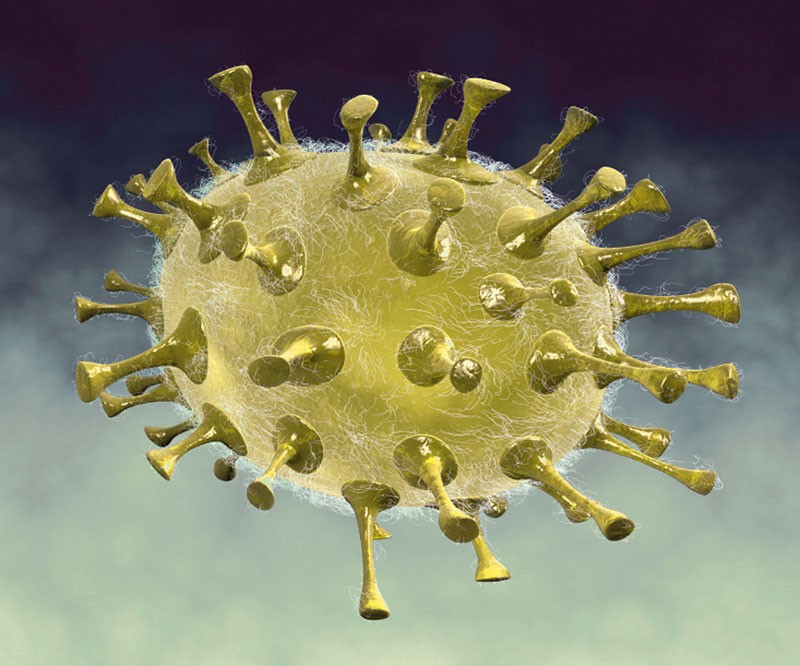












Commentaires