L’évolution de la société, plus égalitaire et moins verticale, la diffusion des savoirs entraînant l’augmentation des connaissances en matière de santé des citoyens, l’épidémie des maladies chroniques nécessitant un transfert de compétences des soignants aux patients ont remis en cause le modèle traditionnel de la relation praticien/malade. Ce modèle parental plus ou moins autoritaire et bienveillant, mais dans tous les cas infantilisant le patient, est né de la maladie aiguë sévère où fréquemment le patient se défend psychologiquement en régressant. Il est d’ailleurs frappant que le dernier mot du mourant, quel que soit son âge, soit bien souvent « maman ».
Si la relation patient/malade doit être égalitaire, d’adulte à adulte, il ne faut cependant pas oublier que cette relation est asymétrique. Le patient a droit à la vérité, mais il a aussi le droit de ne pas savoir ou de ne pas tout savoir ou pas tout, tout de suite. D’où l’art de l’annonce du diagnostic d’une maladie sévère, particulièrement quand on ne connaît pas encore le patient. On ne jette pas à un diagnostic de cancer à la figure des gens, comme on le voit faire trop souvent aujourd’hui. Ce n’est pas au radiologue, au biologiste ou à l’infirmière d’annoncer le diagnostic de maladie grave, mais au médecin ne se cachant par-derrière « la consultation d’annonce ». Encore faut-il qu’il sache prendre le temps, choisir un lieu approprié, procéder si besoin par étapes, permettre au patient d’exprimer son angoisse et de formuler ses questions, revoir ce dernier de façon très rapprochée et l’assurer de sa disponibilité. Ni le téléphone, ni le mail, ni le SMS, ni Skype ne sont des outils appropriés pour le diagnostic de maladie grave qui doit se faire en permettant au patient de regarder le médecin dans les yeux et au médecin de toucher le patient pour lui témoigner son empathie et son engagement à ses côtés. Ils peuvent être en revanche des vecteurs très utiles pour l’accompagnement.
La relation praticien/malade varie selon les caractéristiques de la maladie : est-elle symptomatique ou asymptomatique, voire réduite à un facteur de risque ? Est-elle visible ou échappe-t-elle au regard des autres ? Existe-t-il un traitement ? Quels sont son efficacité, ses effets secondaires et ses contraintes ? Et quelles sont les compétences d’auto-soins que le malade et/ou son entourage doivent acquérir ? Quelle est la gravité de la maladie et son évolutivité : peut-elle guérir ou une récidive est-elle toujours à craindre ? Évolue-t-elle par crise ou est-elle stable, ou l’évolution se fait-elle inexorablement vers l’aggravation ? Autant de situations rendant plus ou moins difficile un travail de deuil ou plus exactement un travail d’acceptation/adaptation.
Bien entendu, la relation dépendra de la personnalité du patient, de son vécu antérieur, de ses croyances, de sa culture et de ses représentations de la maladie et des traitements. Les médecins gagneraient à penser que les êtres humains ne sont pas que des êtres de raison et à développer en conséquence leur capacité empathique pour essayer de mieux comprendre le vécu propre à chaque patient.
Cela dit, notre société postmoderne à la fois scientifique, technique et consumériste, à la fois égotique et communautariste, à la fois relativiste sans dieu ni expert et nostalgique de Jupiter et à la recherche de gourous, hyperinformée mais soupçonneuse et finalement désorientée, ne sachant plus à quel saint se vouer, produit une grande variété de modèles relationnels. À côté du modèle paternaliste d’antan infantilisant, décidant à la place du patient de ce qui est bon pour lui, on trouve :
– le modèle « scientifique » réduisant le malade à sa maladie ;
– le modèle moderne « prestataire de services », informatif-explicatif-délibératif-contractuel gommant tout affect relationnel ;
– le modèle « relativiste » effaçant l’asymétrie de la relation praticien/malade au nom de l’autonomie du patient ayant le « droit à ne pas se soigner », comme si l’annonce du diagnostic n’avait pas pu briser en partie l’autonomie du patient et comme si l’autonomie était un absolu alors que toute la vie n’est qu’une coconstruction ;
– le modèle du « docteur Knock » médicalisant la vie, inventant des maladies, suscitant l’angoisse des patients et les manipulant à des fins commerciales.
Le modèle que nous devons développer est celui de l’empathie. Encore faut-il que celle-ci ne soit pas simplement cognitive, mais également émotionnelle, qu’elle permette la réciprocité et qu’elle débouche sur une proposition d’aide inconditionnelle à la résilience. La relation praticien/malade n’est plus alors une relation à deux, mais à quatre, chacun pouvant prendre la place de l’autre tout en gardant la sienne. C’est ce qu’évoquait D. Winnicott lorsqu’il parlait d’un jeu « d’identifications croisées ». Voilà ce à quoi ne forme pas la faculté, mais ce à quoi pourraient aider l’art et le roman, grâce à leur jeu de dédoublement du spectateur ou du lecteur.
On ne parle aujourd’hui de relation « centrée sur le patient », mais on oublie que pour se centrer sur le patient, il faut pouvoir se décentrer de soi. À cela, il y a deux conditions : d’une part une identité professionnelle forte forgée par la connaissance et l’expérience, d’autre part une sécurité émotionnelle à la fois personnelle et relationnelle. Ce n’est à l’évidence pas le cas de l’étudiant en médecine, comme l’a bien montré le film Hippocrate. C’est pourquoi la réforme des études médicales suppose à la fois une révision de la formation et de la sélection des enseignants et une réforme des modalités de sélection et de validation des étudiants.
Pour en savoir plus : André Grimaldi, Yvanie Caillé, Frédéric Pierru, Didier Tabuteau.
Les maladies chroniques, vers la 3e médecine. Éditions Odile Jacob, 2017.

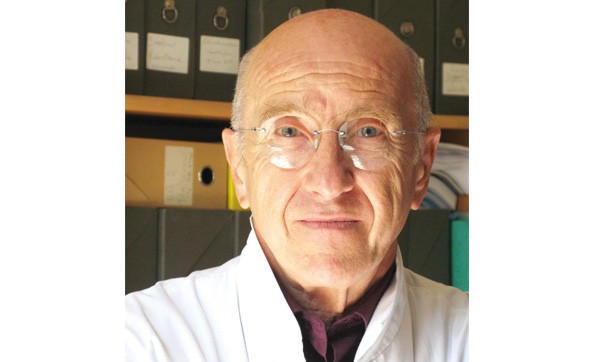












Commentaires