La gestion des douleurs oro-faciales est un facteur important de notre activité pour le bien-être des patients, mais elle concerne aussi les animaux de compagnie. Nous avons vu dans de précédentes revues de presse que nos animaux, en particulier les chiens et chats étaient eux aussi confrontés à des problèmes dentaires ou des pathologies oro-faciales, parfois spécifiques mais souvent assez similaires à ceux de nos patients. Ces différentes affections aiguës ou chroniques sont source de douleurs diverses que les vétérinaires doivent pouvoir identifier puis gérer. C’est le thème que nous avons choisi de vous proposer pour cet Id Mag dont l’ambition est de s’ouvrir vers d’autres domaines médicaux.
L’article rapporté, publié dans la revue de médecine vétérinaire Journal of Veterinary Dentistry, fait précisément un point d’état des connaissances et recommandations en matière de compréhension et de gestion de la douleur chez les animaux domestiques. Cette revue narrative nous indique que ces derniers connaissent une diversité de douleurs similaire aux humains, mais avec la différence fondamentale qu’ils ne sont pas en mesure de la décrire ni même, parfois, de l’exprimer, tant et si bien qu’une douleur présente peut être largement sous-estimée, alors même qu’elle affecte considérablement le bien-être de l’animal. C’est particulièrement le cas des douleurs oro-faciales. Pour mieux les comprendre, les auteurs expliquent tout d’abord les différents mécanismes du parcours du message nociceptif qui, comme chez les humains, est véhiculé par les branches maxillaire et mandibulaire du nerf trijumeau pour générer un message de douleur dans le noyau caudal du bulbe rachidien. Les différentes molécules et récepteurs mis en jeu dans la chaîne de la douleur sont autant de vecteurs susceptibles d’affecter ou prévenir la douleur qui suit un parcours à 5 niveaux. La transduction en est la première phase, là où se crée l’impulsion électrique nociceptive dans les terminaisons nerveuses sensitives. La transmission est la propagation de ce signal dans la moelle épinière ou le bulbe rachidien, puis la modulation fait varier le signal dans le noyau caudal de la moelle épinière par la mise en jeu de neurotransmetteurs capables de l’amplifier ou l’inhiber ; la projection est le stade où le signal modulé atteint le thalamus via des neurones de second ordre puis le cortex, là où il est consciemment perçu. La perception met alors en jeu des afférences émotionnelles qui impliquent aussi des expériences passées telles que l’anxiété et la peur. Toutes ces étapes du parcours nociceptif peuvent être modulées par différents types de médicaments.
L’article explique aussi qu’il existe chez l’animal, comme chez l’humain, différents types de douleurs dont il fait l’inventaire. Ainsi, la douleur adaptée est le mécanisme de douleur aiguë « physiologique » dont le rôle est de protéger l’organisme en évitant ou en stoppant la cause susceptible de créer des dommages, et en permettant la cicatrisation. Les douleurs inflammatoires font partie de cette catégorie. Ce type de douleur aiguë concerne, par exemple, les traumas, les expositions pulpaires, les fractures osseuses, etc. La douleur inadaptée (chronique ou pathologique) apparaît lorsqu’une douleur adaptée n’est pas résolue. Même si le facteur causal a disparu, le message nociceptif persiste. De nombreuses pathologies orales exposent les chiens et les chats aux douleurs chroniques, surtout si elles ne sont pas prises en charge rapidement. C’est le cas des infections parodontales et péri-apicales, des affections stomatiques ulcérantes ou des syndromes particuliers comme le « syndrome de douleur orale félin » chez le chat. Les douleurs neuropathiques sont des douleurs chroniques sans cause identifiée. Elles peuvent résulter d’une lésion d’un nerf ou d’une stimulation nociceptive continue trop longue. Les inflammations chroniques et les mécanismes du vieillissement peuvent aussi donner lieu à des douleurs chroniques, tandis que les cancers produisent des douleurs spécifiques dues à la destruction des tissus, y compris des nerfs, impliquant des processus inflammatoires douloureux et une perturbation des neurotransmetteurs modulant les signaux nociceptifs. Enfin, des douleurs multimodales associent différents types de mécanismes douloureux précités.
Parmi les différentes molécules pharmacologiques permettant d’agir sur les différentes phases de la douleur chez nos animaux domestiques, l’article évoque d’abord les anesthésiques locaux qui bloquent la transmission de la douleur vers le système nerveux central. Les opioïdes incluant, entre autres, la morphine et le fentanyl, agissent sur des récepteurs présynaptiques et bloquent à la fois la transmission et la transduction du signal. Ils provoquent une analgésie globale et préviennent la sensibilisation. Les anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS) inhibent la cascade de prostaglandines inflammatoires, mais provoquent chez les animaux les mêmes effets adverses que chez les humains (douleurs gastro-intestinales, nausées, ulcérations). Bien supportés chez les animaux enw bonne santé, les AINS sont communément employés en médecine vétérinaire pour les douleurs dentaires. Les antagonistes du N-methyl-D-aspartate comme la kétamine sont aussi envisagés pour les douleurs inadaptées du fait de leurs effets antihyperalgesiques. Ils sont aussi employés en per-chirurgical. Parmi les autres molécules remarquables employées chez les animaux de compagnie, on retrouve le tramadol, qui est un agoniste des récepteurs à opiacés, mais aussi un inhibiteur de la recapture de la sérotonine et de la noradrénaline. Efficace chez le chat, sa demi-vie est toutefois moins longue chez le chien que chez les humains.
Au-delà des molécules pharmacologiques, les auteurs relatent des effets très positifs des actions médico-physiques telles que l’acupuncture avec électrostimulation dont les mécanismes exacts ne sont pas encore bien connus, mais qui ont une action analgésique sur les fibres nerveuses véhiculant le message nociceptif. La photobiomodulation par un laser basse intensité agit aussi positivement sur les médiateurs de l’inflammation dans le contrôle du message douloureux. Enfin, certains aliments comme des acides gras mono-insaturés permettent de diminuer dans une certaine mesure la production de prostaglandines. Les auteurs insistent par ailleurs sur les effets bénéfiques de l’hygiène bucco-dentaire, en particulier un brossage des dents régulier pour diminuer le facteur causal, tout en concédant la difficulté de l’appliquer à certains animaux.
La partie la plus intéressante de cet article, pour ce qui est de la compréhension de la spécificité vétérinaire, concerne l’appréciation de la douleur perçue par nos compagnons qui ne peuvent ni la décrire et ni même forcément l’exprimer. En effet, les auteurs rappellent que la douleur est une expérience très individuelle influencée par des facteurs physiques, émotionnels, environnementaux ou encore sociaux, et que cette perception subjective est très difficile à apprécier par les vétérinaires. Certains signes ou comportements tels que la position du corps, les expressions faciales, les interactions avec les personnes ou les autres animaux, la réponse aux contacts et les changements d’activité peuvent néanmoins donner des indices utiles. Mais certains de ces signaux peuvent aussi être l’expression du syndrome peur/angoisse/stress éprouvé par les animaux chez le vétérinaire. Ils insistent aussi sur des signaux trompeurs comme le maintien d’une alimentation quasi normale qui pourrait masquer des douleurs orales bien réelles. Cela s’explique par le besoin de base que constitue l’alimentation dans la survie et qui incite un animal à manger malgré la douleur. Cela est particulièrement vrai chez le chat qui masque énormément ses douleurs. Certaines échelles d’évaluation de la douleur ont cependant été développées en se basant notamment sur l’expression faciale. L’article cite en exemple le « Feline Grimace Scale » (échelle d’expression faciale féline) qui existe désormais sous une version boostée par une intelligence artificielle.
La gestion de la douleur chez les animaux domestiques repose donc sur son estimation et l’application de stratégies de recours aux différents types d’analgésiques. Comme pour nos patients, les auteurs expliquent que des analgésies préventives et des mesures de prévention de la nociception conduisent à de meilleures suites opératoires, une rémission plus rapide et un moindre risque de douleur inadaptée. Des stratégies multimodales associent avantageusement plusieurs types de molécules et/ou des actions non pharmacologiques afin de cibler différentes étapes du parcours nociceptif. Parmi les médicaments les plus employés chez les animaux de compagnie, les AINS sont utiles à la fois en préopératoire et en postopératoire à la maison pendant 3 à 5 jours. Comme pour les humains, il est plus efficace de prévenir une douleur plutôt que d’essayer de la juguler une fois installée. Les anesthésiques locaux sont recommandés en peropératoire afin de bloquer la transmission du message nociceptif. L’usage des opioïdes est principalement utilisé par les vétérinaires en pré- ou peropératoire pour leur action à la fois analgésique et sédative (méthadone, fentanyl). C’est aussi le cas de la kétamine. Cependant, l’électroacupuncture percutanée en peropératoire permet aussi une meilleure relaxation musculaire du patient et conduit à de meilleurs résultats dans la gestion des douleurs.
L’utilisation des opioïdes en postopératoire, en particulier à la maison, est plus délicate, notamment du fait du risque de détournement volontaire ou accidentel par les propriétaires humains ou leurs enfants (ingestion accidentelle). Une option consiste à réaliser au cabinet vétérinaire une injection à action prolongée de buprénorphine qui peut procurer une action analgésique jusqu’à 4 jours chez le chat. Une forme galénique par voie transmuqueuse orale existe aussi. Par ailleurs, des patchs à diffusion transdermique de fentanyl peuvent être envisagés chez le chat (6-12h d’action) ou le chien (18-24h), mais avec un risque d’accident domestique à considérer. Assez peu efficace chez le chien qui ne sécrète pas la molécule avec laquelle il interagit le mieux, le tramadol l’est davantage chez le chat. Il nécessite cependant une surveillance de ses effets secondaires potentiels (troubles neuromusculaires, fièvre, tachycardie, tachypnée) et n’est par ailleurs pas recommandé en monothérapie. Des alternatives à cette molécule sont donc toujours préférables avec des stratégies multimodales dans lesquels des actions d’acupuncture peuvent donner de bons résultats. Les auteurs concluent alors leur article par un plaidoyer pour une approche multimodale de la gestion de la douleur à toutes les étapes du parcours nociceptif, dans les douleurs oro-faciales en particulier.
Commentaire
En ouvrant nos connaissances vers la médecine vétérinaire, cet article nous fait prendre conscience des nombreuses similitudes, mais aussi des différences qui existent dans la genèse et la gestion des douleurs oro-faciales pour les patients et les animaux de compagnie. Aux patients susceptibles de nous interroger sur la santé dentaire de leurs animaux de compagnie, il est très important de les inciter à une visite de contrôle vétérinaire au moins une fois par an. L’article nous apprend en effet que des problèmes dentaires graves peuvent affecter considérablement le bien-être d’un animal sans que le propriétaire ne puisse pourtant déceler de signes modifiant son comportement. C’est particulièrement vrai pour le chat qui exprime très peu ses douleurs. Dans une revue précédente, nous avions rapporté l’importance de détartrages préventifs réguliers à envisager dès les premières années pour les chiens hypertypes en particulier (petite tête et museau plat). Sur un aspect plus neurophysiologique, l’article souligne les mécanismes de la douleur totalement semblables à ceux de nos patients et l’on retrouve logiquement les mêmes recommandations : action maximale sur la prévention de la douleur et blocage du message nociceptif à tous les niveaux possibles de sa chaîne de conduction, en particulier avant, pendant et après une intervention chirurgicale programmée. On découvre aussi, dans la stratégie multimodale défendue par les auteurs, les bénéfices d’actions non pharmacologiques comme l’électroacupuncture ou la photobiomodulation, encore peu connues dans nos domaines. Elles pourraient apporter des solutions intéressantes pour les patients, en particulier pour les douleurs chroniques inadaptées. Concernant l’arsenal pharmacologique de lutte contre la douleur, des familles identiques à celles utilisées pour les humains sont retrouvées, même si les molécules spécifiques varient un peu (c’est le cas des AINS où des molécules sont spécifiques pour le chien et d’autres pour le chat). Toutefois, le paracétamol, très employé pour les humains, est totalement absent des recommandations vétérinaires. Cela s’explique par le fait que cette molécule est toxique pour le chien et plus encore pour le chat chez qui elle est particulièrement dangereuse.
En dentisterie humaine, le paracétamol ne présente presque pas d’effets secondaires ni de contre-indication. Il fournit une action antalgique puissante, souvent sous-estimée tant par les patients que par les prescripteurs. C’est la molécule de choix pour la gestion des douleurs dentaires dans la limite de ses indications posologiques, soit 4 g maximum par 24 heures chez l’adulte de corpulence normale, repartis en prises de 1 g bien espacées. Au-delà de cette posologie, il devient fortement toxique pour le foie. En cas de douleur persistante ou plus intense, l’ibuprofène est un supplétif intéressant. Cet AINS peut être utilisé en complément entre les prises de paracétamol. La posologie pour un adulte est de 400 mg par prise avec un maximum recommandé de 3 prises par 24 heures (1 200 mg). Attention cependant à ne pas le prescrire chez les patients allergiques à l’aspirine et à ceux souffrant d’ulcère ou de fragilités gastriques. L’ibuprofène est aussi absolument interdit chez la femme enceinte ou susceptible de l’être du fait de son potentiel tératogène dans les premiers temps du développement fœtal. Cet aspect doit être systématiquement vérifié avant toute prescription chez une femme en âge de procréer. Les antalgiques de palier II (opioïdes et assimilés à action centrale) n’ont le plus souvent pas d’indication en dentisterie, à l’exception des chirurgies lourdes (dents de sagesse incluses) ou de lésions particulièrement importantes. Les douleurs les plus intenses auxquelles nous avons à faire face (pulpites et nécroses) sont très bien jugulées par le geste clinique (ouverture de la chambre pulpaire), tandis que c’est l’action des antibiotiques qui sera la plus efficace sur les lésions apicales ou les péricoronarites. Notons aussi qu’à partir du 1er mars 2025, les médicaments contenant du tramadol, de la codéine ou de la dihydrocodéine devront obligatoirement être prescrits sur ordonnances sécurisées (papier épais filigrané sans azurant, mentions obligatoires pré-imprimées en bleu intégrant un système de lutte contre la fraude).






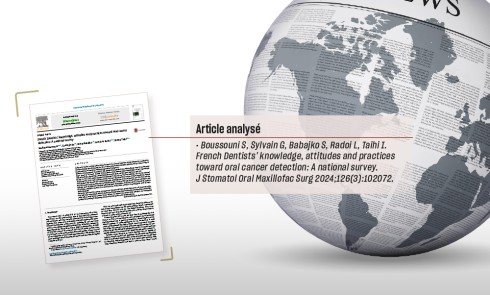








Commentaires