Où est Boilly ?
Le facétieux peintre Louis-Léopold Boilly aimait se dissimuler parmi la foule innombrable de ses grandes toiles, et l’on pense immanquablement au jeu « Where’s Charlie », ou à Hitchcock caché dans ses films, devant cette exposition qui d’ailleurs invite à jouer le jeu de la découverte. Entre deux révolutions, celles de 89 et de 48, Boilly fait le portrait de Paris et de sa population. Grands ou petits, il n’épargne personne et rien ne lui échappe des travers de ses contemporains, qu’il croque sur le vif avec le regard goguenard d’un jeune provincial s’autorisant un droit d’inventaire de la capitale où il vient se fixer depuis son Nord natal. Formé au trompe-l’œil, qui sera l’un de ses talents majeurs, on ne la lui fait pas : derrière les grands airs de la ville-spectacle, il y a toujours des petites mesquineries en coulisses. Il prend aussitôt le parti d’en rire, et d’en faire rire, et ça marche. On s’arrache ses caricatures, ses bouquets de grimaces, le florilège de mœurs de sa comédie humaine, mais aussi ses portraits-express troussés en deux heures et livrés au format standard de 21/16 avec cadre doré, sorte de polaroïd de l’époque. Outre l’attrait humoristique, c’est une mine documentaire pleine de naturel, de vivant et de détails vrais, à l’opposé des poses d’atelier où chacun s’étudie dans une mise en scène arrangée.
On traverse la rue sous la pluie en évitant les fiacres, on se tombe dans les bras au saut de la diligence, on rit avec la marmaille au Polichinelle du jardin public, on s’écrase avec cette canaille d’enragés qui se rue à l’Ambigu Comique comme au sortir d’un confinement. Et toujours, dans un coin, Boilly est là pour nous dire « Non, mais vous avez vu ça ! Et je n’invente rien : j’y étais », jamais en père la morale mais en éternel badaud qui n’en finit pas de se tenir les côtes, témoin et acteur de cette inépuisable gaîté qu’on dit parisienne. À plus d’un titre il annonce l’esprit boulevardier du nouveau siècle, mais c’est aussi un sentimental encore sensible aux effusions d’Ancien Régime, qui peut-être, comme Figaro, « se presse de rire de tout de peur d’être obligé d’en pleurer », se dit-on parfois. Question d’optique. Dans ce domaine d’ailleurs, il collectionne les instruments, très intéressé par les moyens de créer l’illusion dans son art. Quand il nous ouvre les ateliers de ses confrères, c’est un œil sur leur technique, un autre sur le public, ses réactions et le marché qui peut en naître. Son regard de professionnel n’empêche pas celui de l’amateur de curiosités d’un autre genre, glissé volontiers du côté de grisettes qui, quoique peu vêtues, n’ont pas froid aux yeux.
 BOILLY. CHRONIQUES PARISIENNES
BOILLY. CHRONIQUES PARISIENNES
Musée Cognacq-Jay
Jusqu’au 26 juin
L’inoubliable Monsieur Bébé
Le monde entier a en tête celle qu’il a créée pour Jean Marais dans La Belle et la Bête dont il signait décors et costumes et que les effets spéciaux les plus sophistiqués n’ont jamais égalée en pouvoir suggestif sur notre imaginaire. Touche-à-tout de génie comme l’organisateur en mystères Cocteau qui l’appelait « Bébé », Christian Bérard est une figure centrale de la scène entre les années 20 et l’après-guerre. Complice attitré du poète-dramaturge-plasticien-cinéaste, il l’est aussi de Jouvet avec lequel il réinvente les classiques et monte les modernes, Achard, Giraudoux, Genet, entre deux collaborations avec Pierre Fresnay ou Jean-Louis Barrault. Fils d’architecte, cet homme de décor vit corps et âme dans le manteau d’Arlequin et en connaît tous les plis, ceux du théâtre bien sûr, mais aussi du ballet : il rate de peu Diaghilev mais pas Lifar, Balanchine, Massine, Roland Petit dont il encadre et habille les chorégraphies. Ce Bérard-là reste dans les mémoires. Mais beaucoup moins le peintre qu’il voulait être ou l’arbitre des élégances qu’il a représenté pour le Tout-Paris des arts, de la mode, de la haute société qui le sollicitait pour la décoration de ses hôtels particuliers et les bals costumés qu’elle y donnait autant que pour son sens de la fête et l’animation débridée qu’il savait y apporter. Il réapparaît en gloire au Palais Lumière d’Évian qui éclaire à la fois l’homme et l’artiste. On redécouvre l’élève de Vuillard et Maurice Denis salué par la critique et présenté par les galeries aux côtés de Braque, Chirico, Dufy, Laurencin, Léger, Max Jacob, Picasso, Dali ou Lurçat ; le dessinateur de mode ami de Dior et Schiapparelli, inspirateur de Chanel, de Nina Ricci, du tout jeune Saint-Laurent, et collaborateur de Harper’s Bazaar comme de Vogue ; le décorateur des Noailles, Polignac, Rochas, Guerlain, Mauriac, l’illustrateur des ouvrages d’une foule d’écrivains et musiciens, de menus pour la table de grands restaurants, même.
Peintre à la mode, il est mouvant comme elle. Son art est empreint de la légèreté rapide de l’esquisse destinée à une évocation éphémère et poétique retombant avec le rideau. Au cœur des avant-gardes cubistes, futuristes, constructivistes qui structurent l’esthétique d’autres décorateurs de théâtre comme Georges Pitoëff ou Gaston Baty, son trait a la fluidité dansante d’un Dufy, autour de laquelle semble toujours flotter un parfum de parisianisme frivole parlant chiffon au milieu des combats. On n’y reconnaît pas ce qui, à nos yeux d’aujourd’hui, caractérise l’art moderne ; et pourtant il est patent que Bérard avait capté, nombre de témoignages l’attestent, un air du temps associé à la modernité. C’est qu’il manque à notre regard le passage à l’acte, pourrait-on dire, qu’était la matérialisation, l’installation sur la scène de ses projections allusives. Là, elles prenaient corps dans une stylisation qui, mariant dépouillement et raffinement, retrouvait certaines sources primitives du théâtre et rencontrait pleinement l’art de Cocteau ou Giraudoux à revisiter la tragédie classique, un peu daté mais très neuf à l’époque. Sa mort soudaine – sur scène – a empêché Bérard d’épanouir sa cinquantaine dans le grand tournant des années 50. En le tirant de l’ombre, cette exposition remet en scène aussi la théâtrale atmosphère de cet entre-deux-guerres où la France en mal de fées refaisait ses contes.

CHRISTIAN BÉRARD,
AU THÉÂTRE DE LA VIE
Palais Lumière d’Évian
Jusqu’au 22 mai
Génie du Carnavalesco
On connaît le cadre et les fastes du carnaval de Rio, moins ses coulisses. Avant que la rue ne devienne son théâtre, Rio de Janeiro avait une tradition séculaire de bals masqués, mais réservée à l’élite en ses hauts lieux, palais ou grands hôtels, et qui se tenait, sur fond de musique européenne, à l’écart de la population. Laquelle, ne l’entendant pas de cette oreille, menait tambour battant dans ses quartiers ses propres fêtes costumées, en y intégrant au début du XXe siècle les rythmes des Afro-brésiliens établis au centre de la ville, à commencer par la samba née à Bahia au Nordeste. Mixité culturelle et émulation sont ainsi à l’origine spécifique du carnaval carioca, même s’il conserve l’esprit de parade attaché de tout temps et partout à cette trêve libertaire.
À Rio, la Parade de Samba est l’affaire d’écoles acharnées à gagner la compétition annuelle en rivalisant de créativité. C’est le maître mot, et il a son maître d’œuvre : le Carnavalesco. Chef des décors et des costumes, c’est dans ses mains imaginatives que tout se dessine avant que le gigantesque travail ne se déclenche autour du thème choisi. Un respect unanime entoure sa vision, et il agit en directeur de création au vrai sens de ce rôle, c’est-à-dire qu’il donne l’orientation et dirige l’exécution. Bien qu’artisanale dans son essence, la production des immenses chars et des innombrables costumes est une activité quasi industrielle, financée par de grands groupes à travers leurs subventions aux écoles, d’où le très grand rôle économique et social de celles-ci. Tout concourt uniment au même but : afficher fièrement l’ambition d’être reconnus comme les meilleurs, jusqu’aux destaque, ces stars ou personnalités qui trônent en vedette (c’est le sens du mot) au sommet des chars.
Les dessous de cette pharaonique machine, en revanche, ne se montrent pas facilement. Pour découvrir l’ampleur des moyens investis, matériels, humains, artistiques, techniques, il faut aller à Rio. D’ordinaire, en tout cas. Car, chance unique et grâce aux prêts des écoles, ils sont pour la première fois dévoilés beaucoup plus près : au Centre National du Costume de Scène, à Moulins, avec tout le luxe de variété, de détail et d’explication souhaitable. Le parcours, qui nous conduit par les avenues noyées de couleurs, de musique et de danse à Copacabana ou Ipanema et jusqu’aux ateliers et Sambodromes, est un formidable voyage révélant, au son irrésistible de la bateria, toutes les étapes de la préparation et les secrets de la fabrication. Stupéfiante d’art et d’inventivité, la beauté sophistiquée des quelque 120 costumes présentés brasse et renouvelle en permanence – parfois par de simples mais inspirés détournements d’accessoires – un fond trop vite et superficiellement réduit à une débauche de strass et paillettes. C’est infiniment plus riche, savant et plein d’un sens profond. Car ce qui se rejoue rituellement, c’est la survivance, au milieu d’héritages européens, de cultures ouest-africaines, caribéennes et amérindiennes où chants, masques, danses, incarnations, parades portent une dimension symbolique, spirituelle et identitaire. On regarde d’un tout autre œil les motifs et les composants de ces merveilles, dès lors que l’on perçoit ce dont peuvent être chargés une graine, un os, une pierre, un coquillage, une plume, supports d’une mémoire déracinée et transplantée mais vivace et florissante. Et, sans angéliser un syncrétisme vu comme une panacée, ce qu’on admire ici c’est d’abord la façon dont la mixité est, à tous les sens, travaillée, avec un bonheur qui chasse, un instant, les mauvais esprits de ceux qui la combattent, au Brésil ou ailleurs.
 CARNAVAL DE RIO
CARNAVAL DE RIO
Centre National du Costume de Scène, Moulins
Jusqu’au 30 avril















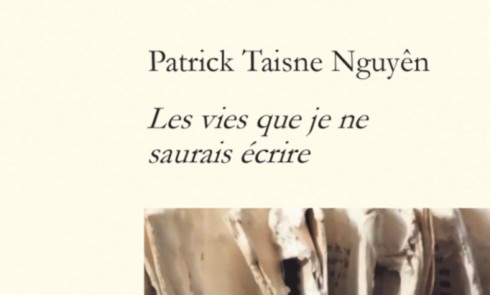







Commentaires