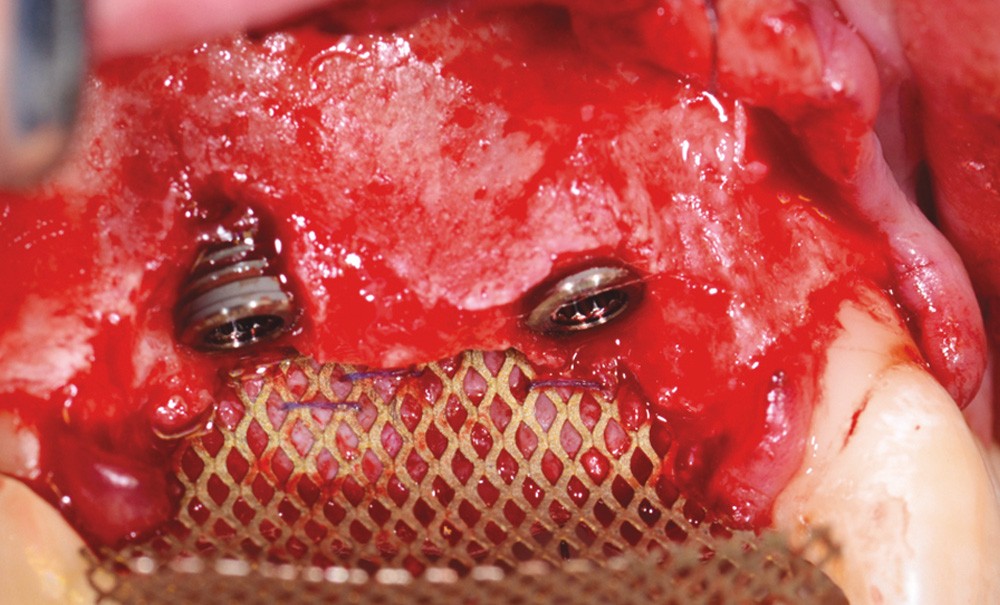Dans la zone esthétique, une épaisseur osseuse de 2 à 4 mm est préconisée antérieurement au col implantaire [2-5]. Elle permet d’anticiper la formation, au niveau du col de l’implant, de l’espace biologique, et de compenser une éventuelle cratérisation qui peut en être la conséquence. Quelles que soient la forme de l’implant et son exposition au milieu buccal au premier ou au second temps chirurgical, qu’il soit en charge ou pas, un espace biologique péri-implantaire se met en place comme c’est le cas autour des dents naturelles. Il se forme dès que l’os est exposé à la flore bactérienne et à l’environnement buccal. C’est un processus physiologique et naturel qui protège l’os en le recouvrant de périoste et de tissu conjonctif, lui-même recouvert d’épithélium.
La hauteur de la résorption est classiquement mesurée de 1,5 à 2 mm à partir de la jonction implant/pilier [6]. Elle s’établit donc à peu près jusqu’à la première spire [7, 8]. La composante latérale est plus difficile à évaluer, elle se situerait autour de 0,45 mm. Toutefois, lorsque deux implants sont contigus, elle augmente lorsque la distance inter-implantaire diminue [6].
Il s’agit donc de trouver le moyen le plus approprié pour reconstruire l’os alvéolaire résorbé et d’anticiper le remodelage osseux péri-implantaire ainsi que le risque de perdre une partie, voire la totalité de l’os augmenté.
Plusieurs techniques sont classiquement proposées et leur choix va dépendre de facteurs généraux et locaux propres aux patients, mais aussi du niveau d’expertise du chirurgien. Plusieurs classifications des défauts osseux ont été proposées dans la littérature pour développer un langage commun et nous aider à choisir la stratégie la plus indiquée.
Benic et coll. distinguent 6 classes de défauts de 0 à 5 et les associent à des indications de traitement [9]. Les trois premières catégories, de 0 à 2, sont des défauts contenus…