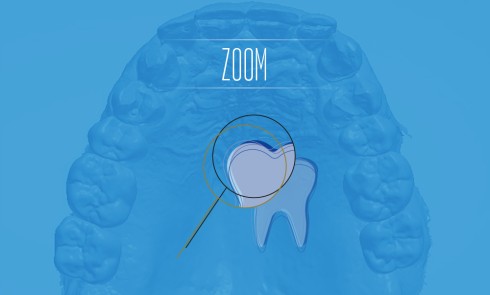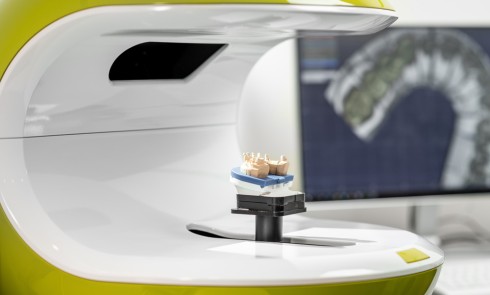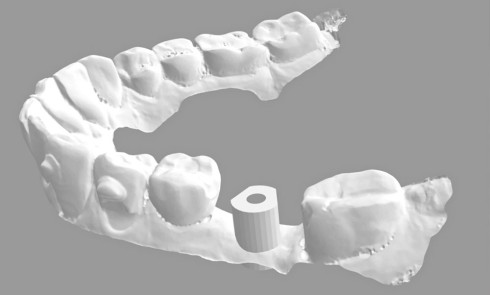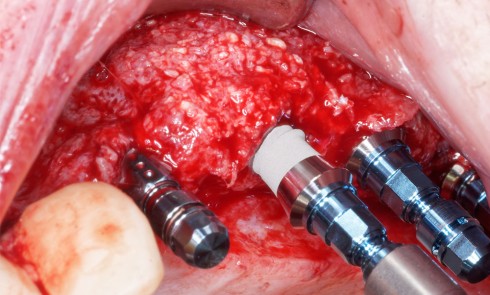La face forme un massif osseux situé à la partie antéro-inférieure du crâne. Elle est constituée de quatorze os, dont douze pairs (les maxillaires, les palatins, les zygomatiques, les nasaux, les lacrymaux et les cornets inférieurs) et deux impairs (la mandibule, le vomer) (1).
Les os de la face limitent entre eux sept cavités. Seule, la cavité buccale est impaire et médiane. Les trois autres sont paires : les fosses nasales, les fosses ptérygo-maxillaires et les cavités orbitaires.
La face est recouverte par de la peau avec des ouvertures au niveau des orifices naturels.
Le massif facial est divisé arbitrairement en trois étages (2) :
• infrastructure : gencive, palais, voile,
• mésostructure : cavité nasale, partie centrale,
• suprastructure : cadre orbitaire.
Les pertes de substance des maxillaires (PDSM) peuvent atteindre tous les éléments constitutifs de la face.
Ces pertes de substance ostéo-cutanéo-muqueuses peuvent avoir des étiologies variées (3).
Les petites pertes de substance acquises entraînant une communication bucco-nasale et/ou sinusienne. Elles peuvent être d’origines traumatiques (balistiques) (4) et/ou accidentelles (5), infectieuses (ostéites, kystes) (6) ou chirurgicales (extractions). Le traitement est le plus souvent chirurgical.
Par contre, les grandes pertes de substance acquises sont la conséquence d’accidents de la circulation ou de tentative d’autolyse, mais aussi et surtout, elles représentent les séquelles des thérapeutiques chirurgicales antitumorales (7).
Les facteurs de risque des cancers des voies aéro-digestives supérieures (VADS) sont essentiellement la consommation d’alcool et de tabac, associée à une hygiène bucco-dentaire défectueuse. Selon la Haute Autorité de la Santé (HAS), plus de 90 % des patients atteints d’un cancer des VADS sont doublement exposés au tabac et à l’alcool. Ces derniers ont un effet synergique qui décuple le risque de développer la pathologie (8).
Prise en charge palliative d’un carcinome épidermoïde de la pyramide nasale : à propos d’un cas
- Par
- Publié le . Paru dans Stratégie Prothétique n°4 - 30 septembre 2014 (page 271-278)


Quelles sont les étiologies des pertes de susbtance maxillo-faciales ?
Comment se déroule la phase prothétique de réhabilitation ?
Comment adapter le traitement en fonction de l’évolution de la pathologie ?
Comment se déroule la phase prothétique de réhabilitation ?
Comment adapter le traitement en fonction de l’évolution de la pathologie ?
Cet article est réservé aux abonnés.
Pour lire la suite :
Vous êtes abonné.e ?
Connectez-vous

Pas encore abonné.e ?
Abonnez-vous

Abonnez-vous pour recevoir la revue et bénéficier des services en ligne et des avantages abonnés.
Vous pouvez également :
Acheter l'article
En version numérique
Acheter le numéro
À l'unité