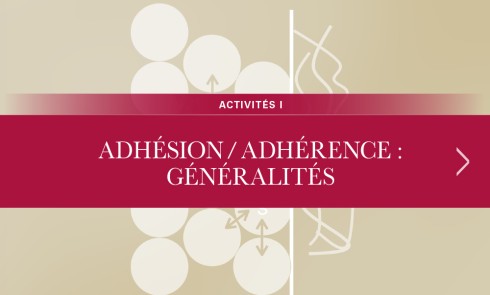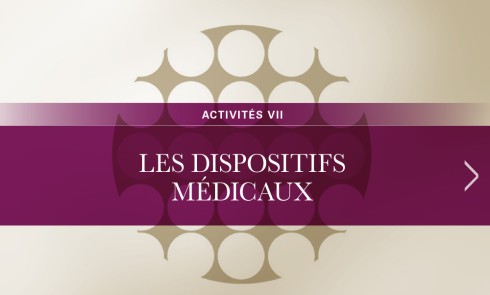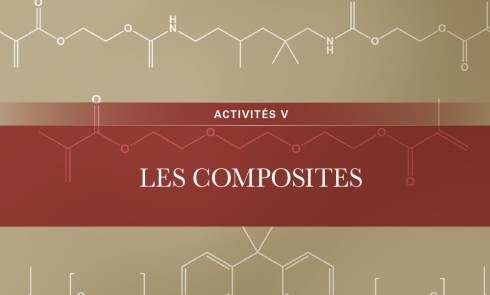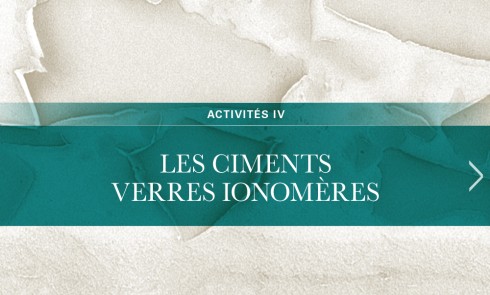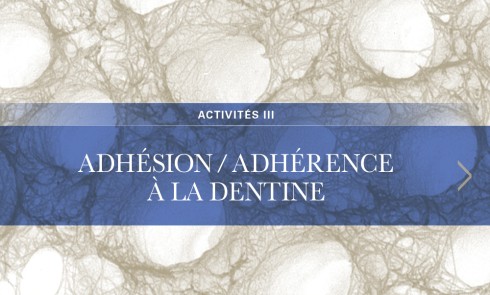Les alliages de cobalt-chrome (Co-Cr) ont une place prépondérante au sein de notre pratique, tant en prothèse fixée qu’amovible. Leurs propriétés mécaniques ont fait d’eux un matériau de choix dans nos infrastructures prothétiques. Avec la mise en place de la nouvelle Réglementation des Dispositifs Médicaux [1], ce paradigme doit être repensé. L’utilisation de ces alliages tend vers une interdiction totale et impose alors recherche et innovation dans le domaine des biomatériaux.
Contexte réglementaire
Avec l’application progressive de la nouvelle Réglementation des Dispositifs Médicaux (2017-2025), la non-commercialisation d’un dispositif médical comprenant une substance dite CMR (cancérigène, mutagène, toxique pour la reproduction) telle que le Co-Cr [2] sera imposée. Cependant, l’absence d’alternative disponible, justifiée par le fabricant, autorise la mise sur le marché du dispositif. De plus, il incombera au fabricant d’informer les usagers par le biais de l’étiquetage et de l’emballage, tous deux réglementés par des normes.
Récemment, le 15 mars 2023, le conseil de l’Union européenne a prolongé le délai pour la certification des dispositifs médicaux contenant des substances classées CMR jusqu’au 31 décembre 2028. Il s’agit officiellement d’éviter des pénuries en invalidant les certificats actuels.
Des risques avérés pour la santé ?
La classification du cobalt en substance CMR trouve son origine dans des études réalisées sur des modèles animaux dont les résultats ne constituent pas des preuves irrévocables [3]. Ainsi, que ce soit en termes de carcinogénicité ou de toxicité pour la reproduction, le risque attribué au cobalt est seulement « supposé » (catégorie 1B). Concernant la mutagénicité, le niveau de risque est encore plus faible et défini comme « préoccupant du fait supposé qu’il pourrait induire des mutations héréditaires » (catégorie 2)… Le tableau…