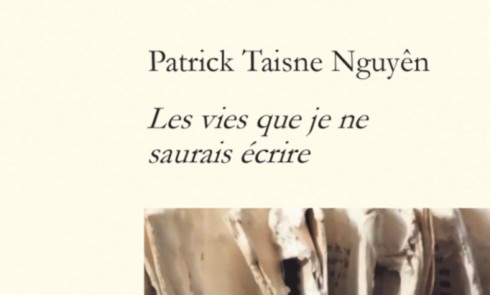La liberté au bout du pinceau
Pas simple, à la fin de l’Ancien Régime, de se déclarer et femme, et peintre. Les deux états auraient même tendance à s’exclure et à obliger les intéressées à choisir : ou femme, ou peintre. Il y a bien certes celles qui peignent en famille, avec leurs pères ou frères, et on note un engouement pour cette profession qui peut offrir une ascension sociale, mais dans l’opinion et vis-à-vis de l’ordre social et moral, leur individuation reste souvent problématique. Au mieux, leurs œuvres sont accueillies avec une aimable condescendance, un indulgent sourire paternaliste, au pire par d’odieux quolibets soupçonnant un homme sous la signature si ce n’est sous le jupon – ce n’est pas d’elles, ou elles ne sont pas femmes – et de façon générale on trouve de l’inconvenance à laisser les filles fréquenter ces ateliers où elles voient Dieu sait quoi et ces galeries du Louvre où logent de jeunes galants. Aussi, pourquoi vouloir sortir du rôle que leur a fixé la nature : épouse, mère, maîtresse de maison ? Un brin de talent de société, passe encore ; c’est le signe d’une éducation accomplie et un « plus » apprécié dans le panier de la dot. Après, c’est de l’effronterie, contraire à la décence et à la vocation d’une femme honnête.
Tenace, ce préjugé va être battu en brèche dès les années 1780 puis à la faveur de la Révolution, mais il regagnera du terrain au cours d’un XIXe siècle tendant à écrire une histoire de l’art sans femmes, et perdure encore du fait de ce passage à la trappe. Une « silenciation » et une « invisibilisation » – ainsi qu’on les analyse désormais – très efficaces, puisqu’à ce jour, seuls les spécialistes savent que les femmes peintres ont existé en nombre durant ce qui a été nommé à juste (et joli) titre « la parenthèse enchantée »*. Jusqu’à cette importante exposition qui, non seulement les sort de l’ombre…