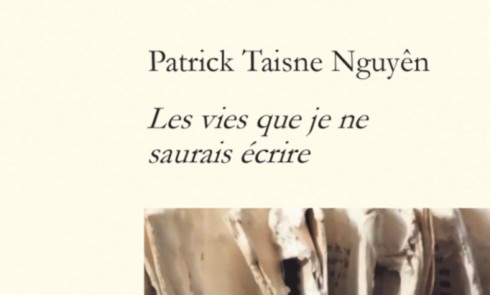La crise de 29, ou comment s’en sortir
Fin 1929, Matisse ne s’inquiète pas de l’événement de l’année, le krach américain, mais du non-événement qui frappe sa peinture. Ce 31 décembre-là marque l’entrée du siècle dans une nouvelle décennie, mais la sienne aussi : c’est le jour de ses soixante ans, et il n’est pas sûr d’avoir du neuf à offrir. Il doute, vasouille au terme de sa série des Odalisques, très fructueuse mais qui l’a achevé, et il sèche face au chevalet : « Devant la toile, je n’ai aucune idée, tandis qu’en dessin et en sculpture ça marche à souhait », confie-t-il à sa fille. Il se force, s’installe pinceau en main, attend. Rien, pas d’inspiration, d’envie, il n’arrive même pas à finir l’entrepris. On fête son talent, à New York comme à Paris, mais à coups de rétrospectives, dont la grande pompe lui fait craindre un enterrement du même ordre. Et plus on encense le Fauve qui a mordu dans l’art moderne, moins il s’en sent les dents. Il lui faut retrouver, pour rejaillir, l’énergie de l’élan primal ou une fontaine de jouvence. Un voyage ? Chiche ! Aux États-Unis, tiens. Et même beaucoup plus loin, vers ce matin du monde, cette Polynésie idéalisée qui fait tant rêver l’époque et les artistes depuis Gauguin.
En 1930, le rêve n’est pas usé et il peut encore tenter un Matisse à bout d’orientalismes. Son goût du primitivisme, affirmé et connu, répond au fond à sa volonté de « retrouver la pureté des moyens », et le mot de primitif s’applique en réalité pour lui aussi bien à Giotto qu’aux objets venus d’Afrique, d’Asie, d’Océanie, de terres amérindiennes qu’il collectionne comme Vlaminck, Derain, Picasso, et qu’Apollinaire nomme « arts des pays lointains ». Mais dans un imaginaire colonial ambiant aussi peu soucieux de géographie que de respect des origines, tout cela se fond dans un exotisme vague et sensuel qui va des rivages orientaux aux…