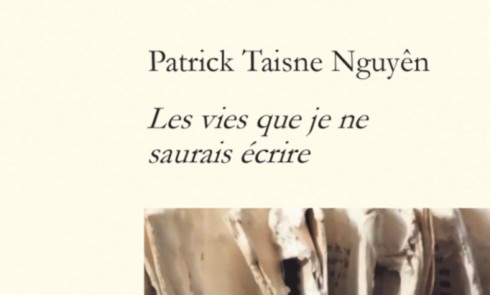Noirs désirs
C’est insidieusement que son Cauchemar frappe à la porte de l’imaginaire, avant qu’on ne prenne soudain conscience qu’il la force, emplissant toute la scène d’une vision d’horreur. Conscience comment et de quelle horreur, on ne saurait le dire nettement ; mais le malaise et l’effroi planent sur ce qui s’est joué entre cette femme prostrée, l’être diabolique qui perché sur elle nous fixe, ce cheval aux yeux de feu dont la tête affolée déchire le rideau. Trop tard, c’est fait. Pour elle peut-être, perdue de corps et de raison s’il ne s’agit pas d’un songe, mais pour nous à coup sûr : en un regard et pour toujours, ce tableau a pris possession de notre âme, doué d’un pouvoir de fascination maléfique qu’on dirait tenu des sorcières de Macbeth et, plus loin, de l’antique Gorgone aux cheveux de serpents, Méduse. Et là-dessus on ne se se trompe pas au fond.
Il y a bien de tout cela dans l’art de Füssli, sur lequel cette exposition lève le voile sans se laisser pétrifier par la toile célèbre qui en occulte parfois la profondeur. L’artiste, redécouvert ici en quelque soixante œuvres très rares, est complexe comme son parcours. D’abord théologien et pasteur dans sa Suisse natale, Johann Heinrich Füssli est pétri de récits bibliques, de mythologie – gréco-latine en particulier, nordique aussi – et il nourrit un goût éclectique pour la littérature, la sculpture, l’anatomie, le dessin, le théâtre, se passionnant autant pour la puissance de Michel-Ange à Rome que pour les sortilèges ombreux de Shakespeare à Londres, où il arrive en 1764. Accueilli par Reynolds à la Royal Academy, Füssli est encouragé à se faire peintre d’histoire et à tracer son chemin dans la voie néoclassique que lui ouvrent son talent et sa culture très érudite. Mais il vise autre chose. Un démon intérieur le travaille obscurément, alimenté autant par l’influence du Sturm und Drang que par celles…