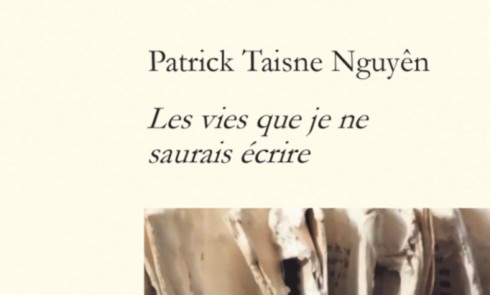Pour une peinture qui en jette
Beaucoup d’eau a coulé sous les ponts des artistes, et beaucoup d’encre pour les critiques, depuis le reproche fait par Ruskin à Whistler de « jeter un pot de peinture à la face du public ». C’était en 1877 à Londres ; le peintre offensé gagne son procès mais le mot le ruine. À Paris en 1905 encore, les Fauves bravent la menace : ils essuient la même critique outrée, lancée par Camille Mauclair du Figaro qui reprend à son compte la célèbre formule. L’usage libre de la couleur, on peine à l’imaginer aujourd’hui, n’est pas alors qu’audace ou exploration hors des sentiers battus. C’est pure provocation, hors de mise et de propos. Il y a des bornes qu’on ne passe pas, de même qu’une peinture doit se limiter au cadre qui la borde, la finit et la définit en tant que tableau, malgré ces originaux d’impressionnistes qui ne marchent pas à la baguette et prétendent peindre au-delà, sur les murs ou les portes*. Ce frustrant diktat de la norme, qui a longtemps sévi, n’est pas que bas de plafond : il nie ou ignore ce que peuvent être pour certains peintres la couleur et le mouvement, aussi essentiels et impérieux que l’appel du corps pour le danseur, du son pour le musicien, de la matière pour le sculpteur, des mots pour l’écrivain, trait d’union de ceux qui dansent, chantent, modèlent ou tracent sur tout, avec tout et partout sans souci de convenance.
Dans ce concert des arts, le pupitre tenu par l’architecture a beaucoup évolué, sans qu’on le perçoive toujours. Dès la fin du XIXe siècle, on a construit des musées hauts, vastes, lumineux. S’ils pouvaient accueillir le monumental, leur esprit demeurait celui du temple élevé au nom d’une haute idée de l’art et de sa place dans l’espace social. Comme tous les édifices publics de prestige, il leur fallait les marques de la théâtralité impressionnante, grands escaliers, colonnes, larges baies, perspectives ouvertes…