La précision d’adaptation constitue le facteur le plus important de succès clinique et de survie à long terme pour les restaurations coronaires complètes en céramique. L’empreinte constitue l’un des facteurs déterminants de cette précision. Certaines études montrent la supériorité des techniques numériques, alors que d’autres concluent en faveur des empreintes traditionnelles. Le but de cette étude était de passer systématiquement en revue les publications existantes pour évaluer la précision d’adaptation marginale de restaurations unitaires complètes en céramique après empreinte numérique ou conventionnelle et d’en faire une méta-analyse.
La stratégie de recherche repose sur la détermination de mots clés selon le cadre PICO (Population concernée, type d’Intervention, Comparaison et Outcome (résultat)) et couvre la période de 1989 à 2014.
Douze études ont été retenues et incluses dans la méta-analyse. Pour les études in vitro, où les restaurations en céramique avaient été réalisées après empreinte conventionnelle, la moyenne du hiatus marginal était de 58,9 µm (IC 95 % : 41,1-76,7 µm), alors qu’après empreinte numérique elle était de 63,3 µm (IC 95 % : 50,5-76,0 µm). Pour les études in vivo, la moyenne du hiatus marginal après empreinte numérique était de 56,1 µm (IC 95 % : 46,3-65,8 µm), alors qu’elle était de 79,2 µm (IC 95 % : 59,6-98,9 µm) après empreinte conventionnelle. L’analyse statistique ne montre pas de différence significative entre les deux types d’empreinte, aussi bien pour les études in vitro que pour celles in vivo. La plupart des procédés numériques inclus dans cette étude fonctionnaient par acquisition directe, ce qui n’a pas permis de les comparer valablement avec d’autres procédés, mais tous permettent de dépasser les critères standard cliniques d’acceptabilité.
Les auteurs concluent de cette revue de synthèse et de cette méta-analyse qu’aucune différence significative n’a pu être mise en évidence au niveau du hiatus marginal observé pour les constructions céramiques unitaires réalisées à partir d’empreintes numériques ou conventionnelles aux élastomères. Ces deux techniques permettent d’obtenir des constructions cliniquement parfaitement acceptables.


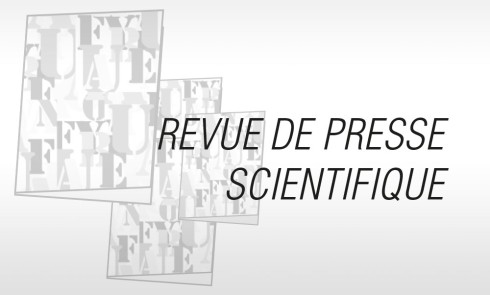
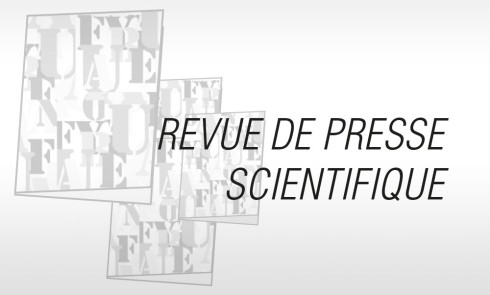
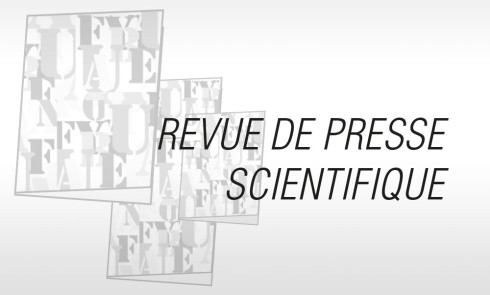
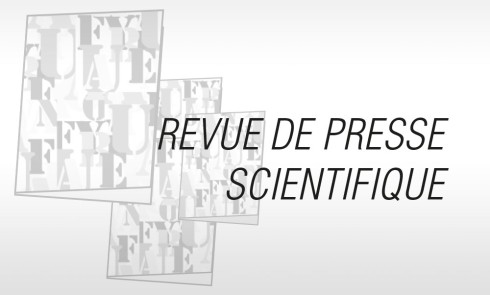







Commentaires